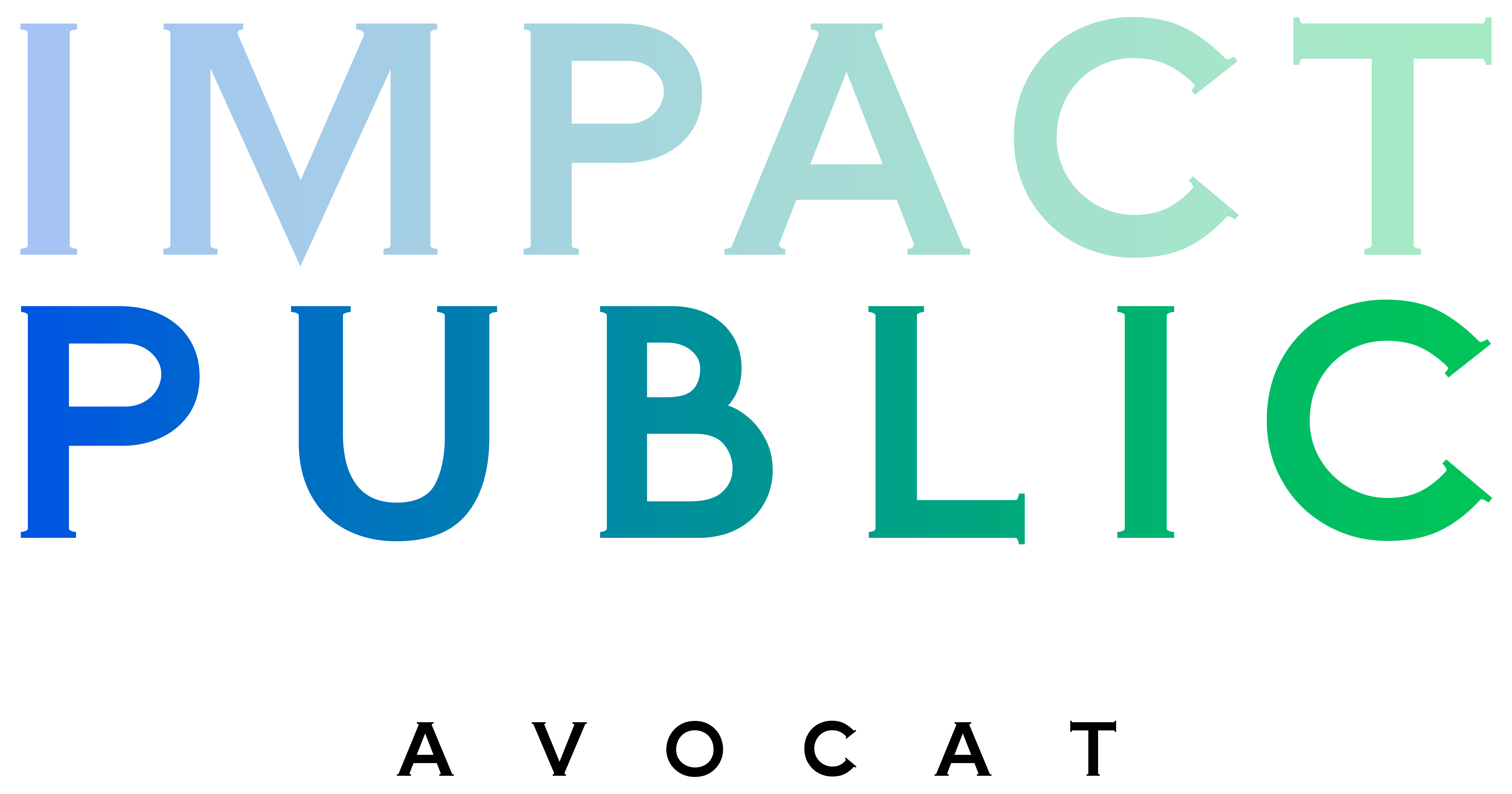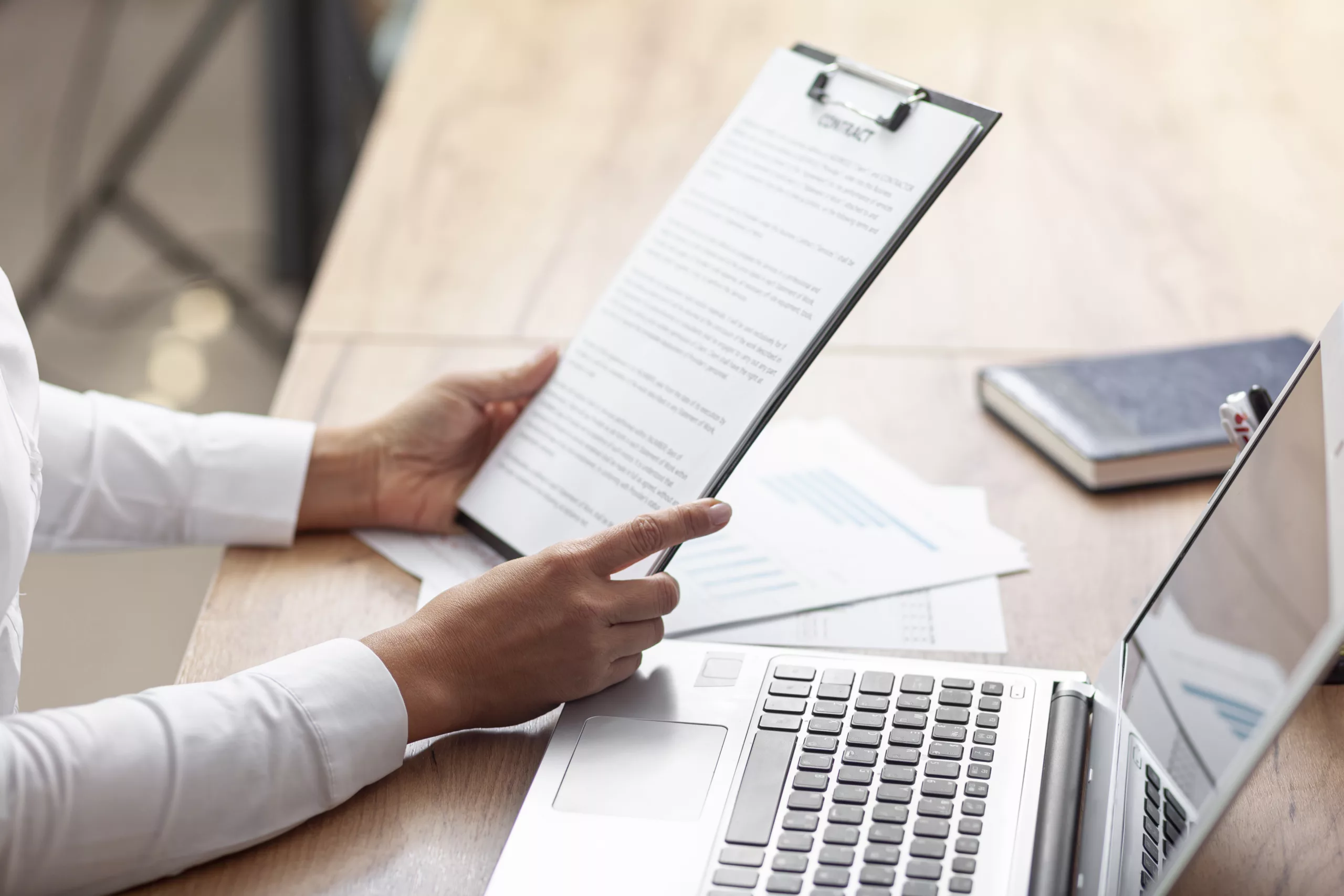
Admission à la retraite : l’administration ne peut opposer une procédure disciplinaire à un fonctionnaire remplissant les conditions légales
Dans un arrêt du 14 février 2025 (n° 493140), le Conseil d’État rappelle que l’administration ne peut légalement rejeter la demande de mise à la retraite d’un fonctionnaire de l’État remplissant toutes les conditions requises au seul motif qu’une procédure disciplinaire est en cours ou envisagée.
En l’espèce, un gardien de la paix, remplissant les conditions prévues par le régime spécial de retraite applicable aux services actifs de la police, s’était vu opposer un refus d’admission à la retraite par la préfète au motif qu’il pourrait faire l’objet de poursuites disciplinaires. Le Conseil d’État annule la décision de rejet, précisant qu’aucun texte ni principe ne permet une telle restriction à un droit à pension acquis.
Cette décision vient renforcer la protection des droits des agents publics à faire valoir leur retraite dès lors qu’ils remplissent les conditions légales, indépendamment de la perspective d’une procédure disciplinaire. Elle pose une limite claire à l’interprétation que l’administration peut faire de son pouvoir d’appréciation dans ce contexte.
Mixité sociale et permis de construire : clarification du seuil d’application de l’article L. 111-24 du Code de l’urbanisme
Par une décision du 11 février 2025 (n° 491009), le Conseil d’État précise les conditions d’application de l’obligation de mixité sociale prévue à l’article L. 111-24 du Code de l’urbanisme dans les communes « carencées » en logement social. Ce texte impose que toute opération de construction d’un immeuble collectif comportant plus de douze logements ou plus de 800 m² de surface de plancher dédiée à l’habitation inclue au moins 30 % de logements locatifs sociaux.
Le Conseil d’État confirme que le seuil de 800 m² doit s’apprécier exclusivement au regard de la surface de plancher affectée à l’habitation, sans considération de la surface totale du bâtiment ni de sa destination principale. Ainsi, un projet comprenant dix logements sur 759 m² d’habitation n’entre pas dans le champ de l’obligation.
Cette clarification renforce la sécurité juridique des porteurs de projets dans les zones soumises à cette réglementation en réaffirmant une lecture littérale et favorable à la densification maîtrisée.


Première affectation d’un agent titularisé : pas d’urgence présumée pour suspendre la décision
Par une décision du 6 février 2025 (n°496294), le Conseil d’État précise qu’une première affectation, à l’issue de la titularisation d’un agent public, ne constitue pas, sauf circonstances très particulières, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.
En l’espèce, une professeure nouvellement titularisée, affectée dans une académie différente de celle souhaitée, sollicitait la suspension de cette décision en référé, invoquant notamment des contraintes familiales et médicales. Le Conseil d’État juge que ces motifs, bien que concrets, ne suffisent pas à caractériser une urgence justifiant la suspension de la décision d’affectation. Il rappelle également que les règles applicables aux mutations ne s’appliquent pas aux premières affectations, lesquelles relèvent d’une logique de gestion nationale des ressources humaines dans l’intérêt du service.
Cette décision réaffirme les critères rigoureux d’appréciation de l’urgence en matière de référé-suspension dans la fonction publique, en particulier lorsqu’il s’agit de premières affectations après concours.
Permis tacite : seule une demande de pièce légalement exigible interrompt le délai d’instruction
Par sa décision Commune de Contes (CE, 4 février 2025, n°494180), le Conseil d’État précise qu’une demande de pièce complémentaire n’interrompt le délai de naissance d’un permis tacite que si cette pièce est légalement exigible au titre du code de l’urbanisme, peu importe qu’elle soit utile ou non à l’instruction.
En l’espèce, la commune de Contes avait demandé deux pièces : seule l’une d’elles entrait dans les prévisions du code (lettre préfectorale relative au défrichement), ce qui suffisait à interrompre valablement le délai d’instruction. La Haute juridiction rappelle ainsi que l’irrégularité d’une demande de pièces complémentaires doit être strictement appréciée au regard des textes en vigueur. En conséquence, un permis tacite ne peut naître si l’administration a réclamé, dans le délai légal, une pièce prévue par la réglementation, même si cette pièce ne conditionne pas la légalité finale de l’autorisation.
Cette décision clarifie la portée juridique des demandes de pièces dans le cadre de l’instruction d’un permis et renforce la sécurité juridique des collectivités dans leurs échanges avec les pétitionnaires. Le Conseil d’État en profite également pour rappeler les critères d’appréciation de l’urgence dans le cadre du référé-suspension.

LES AUTRES ARTICLES
ACTUALITÉS JURIDIQUES – SEPTEMBRE 2023
NOTRE COUP DE COEUR PLAN VÉLO-MARCHE 2023-2027 Le gouvernement a annoncé une enveloppe pour les « mobilités douces » de 2 milliards d’euros mobilisés par l’État, dont 250 millions chaque année pour accélérer le développement des aménagements cyclables sur l’ensemble...